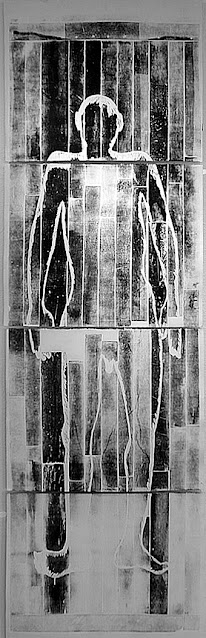Repenser la rationalité. C'est une urgence dit Étienne Klein qui ne comprend plus rien de ses concitoyens. Lui qui parie sur la science pour faire avancer les consciences.
Il faut en effet repenser la capacité culturelle de rationalité face à des manifestations, drogue et réseaux qui privilégient le naturel et favorisent la dérèglementation. Les hors-la-loi, les mafieux sont partout jusque dans les gouvernements qui bannissent les chercheurs de la cité et discréditent les universités.
On n'apprend pas à parler aux singes, disait un inspecteur de l'éducation nationale qui me prenait pour un cuistre et un pédant médiationniste. En arrière plan leur position était claire : l'enseignement des arts plastiques pour favoriser la création n'a pas besoin de sciences humaines trop pointues, trop compliquées pour être absorbées par les petites têtes à qui suffit d'être imaginatifs et habiles de leur main. Bref, il me remettait en place, c'est à dire en arts plastiques et hors de ce que d'autres qualifiaient encore de secte sans pouvoir désigner proprement l'anthropologie clinique puisqu'ils n'avaient pas mis les pieds dans les lieux de son enseignement, lu pas grand chose et seulement écouté à son propos les ragots des colporteurs de l'université.
Tout cela est loin maintenant mais très actuel par les enjeux sociétaux que pose l'individualisme et l'envie d'une liberté mal digérée. Le droit, faussement désigné, de tout dire, de tout faire sans entraves, notamment celles qui balisent le raisonnement et la réflexion ; ce qui serait ringard et réservé aux vieux c... , voire, aux malades...
L'hypocondriaque, le vieux ronchon répond — même s'il a conscience de prêcher dans le désert — .
Et quoi qu'il en soit, revenons sur la « déconstruction » au sens de Jean Gagnepain et non celui de « critique » promu par Jacques Derrida à partir de la littérature.
À la base, il y a la patience du chercheur qui ne se contente pas de l'objet conçu propre au langage et à la représentation. Les incursions du linguiste dans le pathologique, avec l'aide de son acolyte neurologue Olivier Sabouraud, ont permis d'ouvrir le champ du rationnel et d'y inclure ce qui paraît même irrationnel.
Repenser la rationalité dans ces conditions revient à sortir provisoirement (encore une expérience de pensée à la Étienne Klein) du rapport à l'objet scientifique ou pas, à l'image et au langage qui ne peut que désigner un monde de représentations. Il ne s'agit pas d'exclure les mots et leurs choses : le langage fonde la science et la logique, mais l'art et la technique les produisent, les institutions les font exister socialement, et la liberté est n'est forte que de ses lois et règlements.
Il ne s'agit pas de convaincre mais de proposer en exemple une méthode jusqu'à explorer les conséquences des analyses qu'elle inaugure.
Vive la médiation en cette nouvelle année 2026 qui sera vraiment neuve par la prise en compte de l'anthropologie clinique et de ses avancées dans le rapport au langage, l'art, la société et le droit. Pour en savoir mieux : voir le site de l'institut Jean Gagnepain et celui de tétralogiques.


.png)